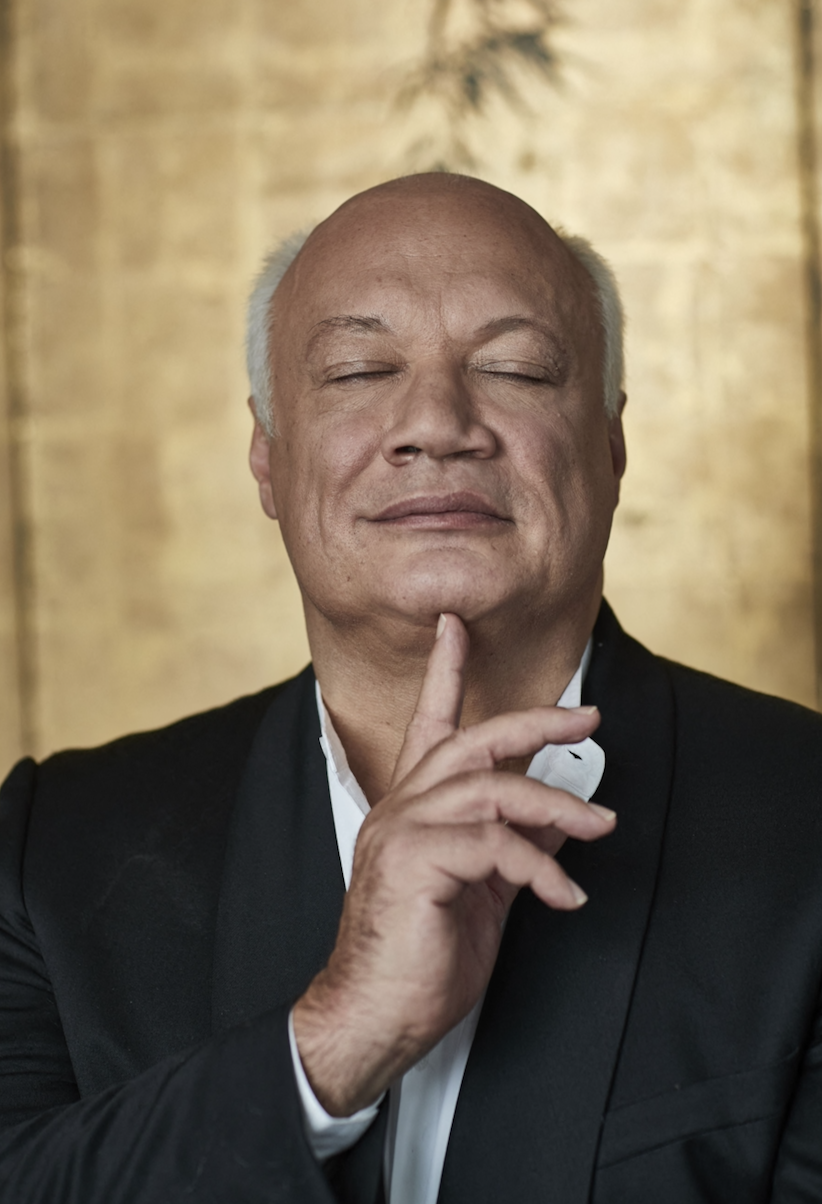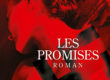Comment a germé l’idée de vous lancer dans La traversée du temps ?
J’avais 25 ans, jeune assistant à l’université de Besançon, j’enseignais la philosophie à ma sortie de Normal Sup. Déjà agrégé, bientôt docteur, je me remettais à lire pour le plaisir de la lecture. Je savourais le pouvoir du roman, c’est-à-dire rapporter la chair, la sensibilité, le goût, l’odeur des choses. Le roman est le contraire de la ruine, c’est le monde tout entier qui revient, non pas ses vestiges. C’est ainsi que m’a traversé l’idée d’un personnage affecté d’immortalité et parcourant les siècles. Ce cadeau apparent se transforme en une terrible prison pour Noam, le héros qui devient témoin et acteur des grands moments, ceux où la civilisation glisse dans une dimension nouvelle, comme de grandes plaques tectoniques qui changent les sociétés. C’était un projet historique, mais aussi philosophique puisqu’il s’agissait de retrouver l’étonnement devant ce qui se passe. Platon disait que la première qualité du philosophe c’est de s’étonner. Historique, car j’ai recherché dans l’Histoire ces instants où se produisent de grandes bascules. Par ailleurs, le défi philosophique consistait à comprendre comment nous sommes devenus ce que nous sommes, en passant des chasseurs-cueilleurs de la Préhistoire à aujourd’hui.
Comment cette œuvre s’est-elle construite ?
C’est une fresque doublement élaborée. Une réflexion historique, relatant les moments où nos sociétés rentrent dans une ère dont elles ne sortiront jamais et comment les strates s’additionnent. Puis, c’est un travail romanesque, pour habiter l’Histoire avec des personnages et un amour sur plusieurs millénaires. Ce double travail, assez monstrueux, m’a permis de concevoir une œuvre de 5000 pages. Sans compter que je refuse d’avoir des recherchistes, des documentalistes. Je n’ai pas confiance, c’est en cherchant que je trouve. En menant un travail de réflexion sur la matière, le roman se dessine. Ainsi, j’ai eu des moments de ma vie où j’ai étudié la philosophie des sciences ou l’histoire économique, pour progressivement les articuler et les utiliser comme une trame pour mes romans.
Cette œuvre est-elle celle de toute une vie ? Le paroxysme de votre carrière d’écrivain ?
C’est prétentieux de dire cela, mais j’ai le sentiment d’un accomplissement personnel et intellectuel. J’ai longtemps très mal vécu avec moi-même, car j’avais ce projet en moi depuis des décennies, mais je n’y arrivais pas. J’avais envie d’être prêt, mais me rendais compte que je ne l’étais pas. C’était à chaque fois une déconfiture, sans que cela ne me décourage pour autant. Je me sentais comme un procrastinateur. Puis, il y a trois ans, je pense que j’avais enfin résolu les difficultés majeures, et tout est sorti avec le naturel qui m’est habituel. C’est le résultat d’une gestation de 30 ans. La patience de l’œuvre, c’est la plus grande sagesse et en même temps la plus grande difficulté des créateurs. Comme disait Racine. « ma tragédie est faite, je n’ai plus qu’à l’écrire ».
Écrire sur les périodes antérieures est sans doute compliqué. Comment avez-vous réussi à en faire un terrain de fiction ?
C’est grisant puisqu’il y a une empathie sur plusieurs millénaires. Le travail d’un dramaturge est doublement empathique. C’est raconté une même situation dans la peau de deux personnes. J’aborde le roman en me substituant à quelqu’un qui vit dans un autre monde matériel que le mien. Cette expérience est extraordinaire, elle permet de renouveler notre vision du monde. J’ai ce don de l’empathie, tout ce que j’ai écrit, c’est en m’appuyant là-dessus. Je peux être un vieillard, une femme, un enfant. Cette démarche intellectuelle m’enrichit, c’est une expérience poétique extraordinaire, comme dans le premier volume par exemple, en vivant dans la nature, comme nos ancêtres chasseurs-cueilleurs pour qui le monde a une âme – le ruisseau, les arbres, la plaine. Mon esprit était là-bas, comme si j’avais gardé une mémoire ancestrale de cette période. Il me semble que certaines personnes naissent dans une époque qui n’est pas la leur, d’où la névrose et la dépression, d’où aussi la littérature et la poésie. Quand on accomplit un art, on arrive à rejoindre ce monde pour lequel on est fait. Notre époque matérialiste transforme le monde en un pur agrégat de matière auquel l’Homme donne des formes. J’écris pour créer une autre expérience du monde, du corps, du rapport aux autres.
Qui est Noam, cet immortel qui va traverser les époques ? Suit-il un parcours initiatique, est-il en recherche de sens ou un simple observateur du temps qui passe ?
Noam est un héros malgré lui. Il n’a pas le goût du pouvoir ou de la richesse. Il devient un héros, car il est responsable et parce qu’il aime. C’est un homme intelligent, simple, mu par des sentiments. Il va découvrir son immortalité avec étonnement, s’en réjouir d’abord et ensuite avoir une vision pessimiste sur destin qui est le sien. Il devient alors guérisseur pour comprendre le secret de la vie afin de soigner les autres et chercher le secret de la mort pour lui-même, car même si l’on aime passionnément vivre, il y a un moment où il est bon d’en finir. J’ai aussi écrit ce livre pour apprivoiser ma propre mortalité.
Quel message souhaitez-vous transmettre à travers les huit tomes de La Traversée des Temps ?
Le parfum de sagesse que j’aimerais diffuser à l’intérieur de cette grande histoire, serait de faire en sorte que le lecteur chérisse son éphémérité, sa mortalité et apprécie la vie telle qu’elle est. Sans être transhumaniste, qu’il soit gourmand de vie. Elle est un cadeau, tout comme la mort, elles ne font qu’un, sont faites de la même étoffe. Dans ces livres, j’ai réalisé un travail de philosophie au sens antique, c’est-à-dire de sagesse pour mieux habiter la condition humaine. Noam est sorti de sa condition humaine pour que les lecteurs apprécient mieux la leur.
Si vous aviez vécu en Mésopotamie à l’époque de cette explosion des connaissances où les bases de notre société actuelle ont été jetées. Quel homme auriez-vous été ?
Dans le deuxième tome, il y a un enfant poète qui s’appelle Maël. J’aurais aimé être cet enfant. On a inventé l’écriture pour compter, la première tablette d’argile est signée par un comptable. Ça a changé notre rapport au monde, il est devenu une somme d’objets. Maël fait de la littérature avec une écriture inventée par les comptables. Il s’en empare et écrit l’Épopée de Gilgamesh. Dans toute invention, il y le paradoxe du bien et du mal, chacune ouvre des horizons formidables et en ferme d’autres. L’écriture a changé notre rapport au monde – la matière est devenue divisible et privatisable – mais, elle a aussi permis d’inventer d’autres univers, décrire les sentiments, imaginer des mondes idéalisés meilleurs que celui dans lequel on existe.
À quelle époque auriez-vous aimé vivre ?
J’adore le 18e siècle, car il y a une croyance, un espoir fou en la rationalité. C’est le siècle que j’ai étudié dans ma thèse, Diderot et la métaphysique. C’est l’ombre et la lumière, une pure rationalité doublée d’une ouverture au mystère. J’aime cette façon cabriolante d’être dans la culture et dans la réflexion. Il y toujours quelque chose d’un peu ludique chez Rousseau, Voltaire ou Diderot et la volonté de s’exprimer par la fiction, pas seulement à travers des essais philosophiques, mais avec une légèreté, une allégresse, un plaisir ressenti et une curiosité fraîche. L’ Encyclopédie de Diderot et d’Alembert est une gourmandise pour moi. L’éclatement de la hiérarchie des savoirs pour dire que tout est intéressant est un ravissement : il est aussi important de connaître la métaphysique d’Aristote que comment faire du pain.
L’anthropocentrisme va-t-il crescendo avec les siècles qui passent ? L’Homme est-il toujours plus arrogant à mesure qu’il s’éloigne de la Nature ?
C’est ce que j’appelle l’enflure humaine. Nous vivons dans une époque unique ou pour la première fois, l’Homme prend conscience de cette enflure humaine. Le sentiment écologique, c’est cela. On réalise que l’on met en danger notre survie. Les hommes ont toujours conté des histoires de fin du monde, comme une projection de leur mortalité. La nouveauté, c’est qu’avant on craignait la colère des dieux, de Dieu ou les caprices de la Nature. Aujourd’hui, le sentiment partagé au 21e siècle, c’est que l’Homme suffit à créer l’Apocalypse. C’est pour cela que Noam, se réveillant dans notre monde, a peur pour la première fois en plusieurs millénaires, et il écrit alors ses mémoires pour comprendre comment on en est arrivé là.
De la vie sauvage à la civilisation, qu’avons-nous perdu ?
L’humilité. Il y a une sagesse écologique chez les chasseurs-cueilleurs. Ils étaient animistes, des habitants du monde parmi d’autres habitants du monde. Ils ne se pensaient pas supérieurs, ne s’imaginaient pas détenir seuls le privilège de l’esprit. On s’est mis au-dessus de la Nature, au-dessus des autres espèces, au point de les détruire. Nous avons perdu ce sentiment d’immersion dans un monde plus grand et plus fort que nous dans lequel nous sommes tout petits. Ensuite est venu le torticolis mystique. Avant les divinités étaient là, parmi nous, puis la matière devient utile, alors on se tourne vers le ciel. On cherche Dieu en haut, on se redresse, mais peut-être trop haut. Nous sommes passés d’une spiritualité horizontale, dans laquelle les dieux nous entouraient, à la verticalité. Plus on avance dans l’histoire, plus le monde fini devient infini, le spirituel devient matériel. Quand on envoie une sonde sur mars, on n’envoie pas une sonde chez Dieu
Sommes-nous à quelques secondes d’un nouveau déluge, de la fin du monde ?
Je suis très inquiet de notre enflure, de notre suroccupation de l’espace, du fait que l’on puise dans cette Nature comme si elle était inépuisable, que nous fassions disparaître des espèces sans le souci des autres vies. Je comprends la capacité de l’Homme de s’adapter et de réagir mais, je suis disciple de Kant, je ne crois au progrès que par la catastrophe. Comme la naissance des instances internationales après des guerres terriblement meurtrières. Si les signes d’alerte ne sont pas suffisants pour certains aujourd’hui, il faudra qu’il y ait des catastrophes absolues. Mais je crois en la capacité de l’homme à progresser à l’issue de chaque catastrophe. Je crois au progrès par le mal. Ma lucidité me rend douloureux, mais je reste optimiste. La lucidité c’est toujours la douleur, pourtant je la préfère au narcotique de l’ignorance. Tout va tellement mal qu’on va trouver un moyen d’aller mieux. L’optimisme est le jus de mon désespoir.
Copyright : Bestimage/ Cyril Moreau